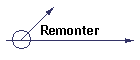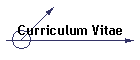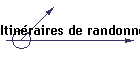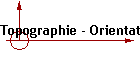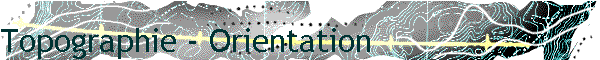
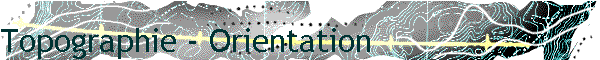
Le support de stage peut être téléchargé.
Tout ce que je sais sur le cheval et la randonnée équestre, je l'ai appris en lisant beaucoup ( mes auteurs favoris sont les grands randonneurs comme Jean-François Ballereau et Stéphane Bigo qui relatent leurs voyages ou Emile Brager qui a sorti dernièrement un livre très complet sur les "Techniques du voyage à cheval" ) et en pratiquant beaucoup aussi ( plus de 3000 km de randonnée, seul ou à deux, 3 Equirandos et 2 participations au Championnat de France de TREC ).
J'ai essayé de structurer les lignes qui suivent comme j'aurais aimé les trouver dans un livre, en essayant de suivre une démarche logique et une progression conforme à mes idées.
Je pense en effet que le plus important pour un randonneur est de savoir lire et interpréter une carte, tout le reste n'est qu'accessoire et vraiment utile qu'en compétition.
Lorsque j'ai participé au Rallye International de Tourisme Equestre de Parthenay en 1984, j'ai perdu ma boussole le premier jour ( j'ai perdu beaucoup de choses cette journée là ¼ ) et cela ne m'a pas empêché de parcourir 700 km seul avec mon cheval, en passant par la Creuse et le Limousin, dans des régions montagneuses où souvent le chemin se perdait dans la forêt : il fallait alors "improviser".
Je ne me suis muni d'une boussole ( une vraie ) que lorsque je me suis lancé dans le TREC.
J'espère que ces quelques lignes vous permettront de ne pas vous égarer, de vous donner matière à répondre aux questionnaires des rallyes et de vous faire parvenir en bonne position au classement du TREC et du Challenge du Cavalier et du Cheval d'Extérieur.
La carteReprésenter à plat ( carte ) une surface courbe ( Terre ) est un problème mathématique qui n'admet aucune solution sans déformation.
Essayez en effet de représenter à plat un ballon de football et vous comprendrez le problème qui se pose à tous les topographes.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées à partir du moment où l'on accepte que la représentation à plat ne sera pas l'exacte réplique de la surface courbe considérée, c'est à dire, à partir du moment où l'on accepte que des déformations existent : dans ce cas, on aborde le problème des "projections".
Les systèmes de "Projection"On distingue deux modes de "Projection" :
| les projections qui conservent les angles = projections conformes. | |
| les projections qui conservent les superficies = projections équivalentes. |
Partant de là, trois systèmes de projection sont à retenir :
Projection conforme due au navigateur Hollandais Mercator ( XVI° siècle ), elle consiste à envelopper la terre d'un cylindre de papier tangent à l'équateur et à projeter chaque point de la Terre sur ce cylindre.
Une échelle latérale permet d'apprécier les distances.
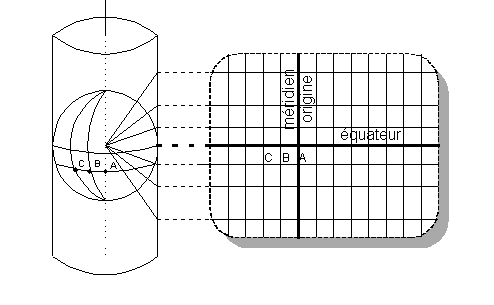
Ce système est utilisé dans la marine.
U.T.M. = Universal Transverse Mercator.
Projection conforme choisie comme système international, elle s'apparente à la Projection Mercator, mais ici, la tangence est réalisée le long d'un méridien.
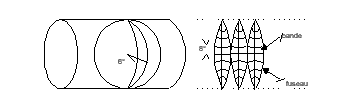
La terre se trouve ainsi divisée en fuseaux de 6° chacun désignés par un chiffre ( 60 fuseaux possibles ), chaque fuseau étant divisé par des bandes de 8° désignées par une lettre ( 20 bandes possibles ).
La zone est définie par une bande comprise dans un fuseau, chaque zone est divisée en carrés de 100 km de côté.
Ainsi la France est couverte par les fuseaux 30, 31 et 32.
Projection conforme et conique.
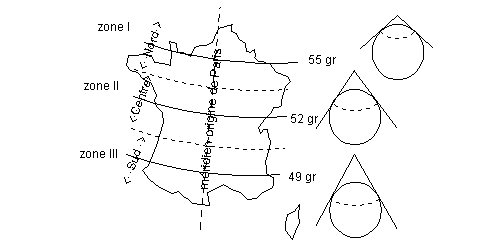
Afin de limiter les déformations, la France a été divisée en 3 zones correspondant à 3 cônes légèrement sécants et décalés de 200 km dans le sens Nord-Sud.
Le Méridien origine est celui de Paris, il porte la numérotation 600 km pour éviter les coordonnées négatives.
L'Institut Géographique National est le principal organisme en France qui fournit au public les cartes de notre pays, cependant, on peut citer les cartes Michelin ( réseau routier ) et les cartes RICHARD ( randonnée en montagne ).
L'IGN publie des documents réalisés à partir de photographies aériennes et de relevés sur le terrain et ce, suivant plusieurs échelles reconnaissables par leur couleur : ainsi la série rouge au 1/250000 a une vocation "carte routière", la série verte au 1/100000 a une vocation "carte touristique", les séries orange au 1/50000 et bleue au 1/25000 ont, elles, une vocation "carte de randonnée".
A noter que depuis quelques années, l'IGN a décidé de ne plus mettre à jour les cartes de la série orange : ne se trouvent encore dans le commerce que les fins de stock.
Le randonneur équestre utilisera la série verte pour "dégrossir" une randonnée : si celle-ci a lieu en plaine, il utilisera la série orange pour le tracé de son itinéraire ( suffisamment précise et ayant l'avantage de prendre peu de place dans les sacoches ), et en revanche, s'il y a du relief, il fera appel à la série bleue plus précise, utilisée aussi pour les épreuves d'orientation.
L'échelle d'une carte est en fait l'expression d'un rapport de distances : sur une carte au 1/25000, 1 cm représente 25000 cm ( soit 250 m) sur le terrain, de même, sur une carte au 1/50000, 1 cm représente 50000 cm ( soit 500 m ) sur le terrain.
En résumé, pour une échelle au x/y, x cm sur la carte représentent y cm sur le terrain.
Il faut avoir présent à l'esprit en permanence le moyen de calcul des distances et savoir par exemple, sans réfléchir plus longtemps ( mais avec l'aide d'une calculatrice éventuellement ), qu'une distance de 1850 m sur le terrain se représente par une longueur de 7.4 cm sur une carte au 1/25000 et par une longueur de 9.25 cm sur une carte au 1/20000.
L'échelle de la carte est indiquée en bas des légendes : si la cartouche des légendes est absente, on peut retrouver l'échelle de la carte en regardant le cadre qui entoure la carte ( les chiffres indiqués évoluent de km en km, si la distance entre deux de ces chiffres est de 4 cm, cela indique que 4 cm sur la carte représentent 1000 m sur le terrain et on a donc une carte au 1/25000 ).
Il existe dans le commerce des règles qui donnent directement les distances suivant l'échelle utilisée : ces règles ne sont pas très pratiques quand l'itinéraire à mesurer est sinueux.
Dans ce dernier cas, il convient de se procurer un curvimètre, instrument qui permet avec une relative précision de mesurer un itinéraire ( on trouvera dans le commerce des curvimètres électroniques qui calculent la distance quelle que soit l'échelle en cause, mais attention à la panne ).
Remarque : la distance déterminée avec la carte n'est pas forcément celle qui existe sur le terrain surtout si le relief est important.
Le découpage et la numérotationLe tableau d'assemblage des cartes au 1/50000 fait apparaître un découpage en feuilles suivant la projection de Lambert.
Pour les cartes au 1/50000, la numérotation se fait avec 4 chiffres : les 2 premiers déterminent la bande Nord-Sud ( croissants de l'Ouest vers l'Est ), les deux derniers déterminent la bande Est-Ouest ( croissants du Nord vers le Sud ) et chaque feuille couvre un territoire de 28 km sur 20 km ( soit 56 cm de large pour 40 cm de haut ).
Pour les cartes au 1/25000, la numérotation est la même mis à part que chaque feuille précédente ( 1/50000 ) se divise en 2 feuilles au 1/25000 repérées par l'indication "Est" ou "Ouest" et cette fois, chaque feuille couvre un territoire de 14 km sur 20 km ( soit 56 cm de large pour 80 cm de haut ).
Le langage de la carteLa carte est une représentation réduite de la réalité, il n'est bien sûr pas possible d'y faire figurer tout ce qui se trouve sur le terrain, cependant, à l'aide de signes conventionnels, on peut arriver à donner une bonne image de la réalité à l'utilisateur, à condition que celui-ci ait pris la peine de les apprendre.
Ces signes conventionnels sont rappelés dans la légende de la carte, mais il convient d'en connaître un certain nombre par coeur.
Ainsi, il faut savoir que tout ce qui est vert sur la carte représente de la végétation : un trait vert est une haie limitant une parcelle, un trait vert avec des points est une haie avec des arbres ( donc visible de loin ), un trait vert prononcé indique une limite de forêt domaniale ou de parc naturel, une surface verte indique un bois ou des brandes ou des cultures particulières : on peut même avoir une indication des essences.
La couleur bleue est réservée à l'eau, que ce soit le réseau hydrographique ( trait plus ou moins prononcé en fonction de l'importance du cours d'eau ), ou des points particuliers comme les châteaux d'eau, les citernes et les puits qui peuvent servir de repères sur le terrain.
La couleur rouge est réservée à l'infrastructure routière suffisamment importante pour que nous cherchions à l'éviter.
La couleur noire est réservée à tout ce que l'homme a pu construire et qui ne représente pas, à priori, un danger certain pour nous cavaliers randonneurs.. Il faut absolument connaître le symbole d'un hangar, d'une tour, d'une éolienne, d'un terrain de sport, d'une église, d'un cimetière ( eau potable ), de la mairie ( Equirando ) ¼
Les chemins sont indiqués par un trait noir : il faut savoir que tous les chemins portés sur la carte ne sont pas forcément ouverts à la circulation des cavaliers et en tous cas, si un chemin a été labouré, ce n'est pas parce qu'il est porté sur la carte que le cavalier a le droit de traverser la culture, il convient dans ce cas de vérifier au cadastre le caractère communal du chemin. De plus le droit rural nous autorise à emprunter un chemin, qu'il soit porté sur la carte ou non, à partir du moment où aucune interdiction n'est indiquée ( bénéfice du doute ).
Les limites administratives sont elles aussi portées en noir et il peut être intéressant de savoir les reconnaître : il s'agit d'une alternance de tirets et de points - plus il y a de points, moins importante est la limite ( pour la commune, il n'y a que des points ).
La dernière couleur utilisée est le orange : on s'en sert pour indiquer le relief et les modifications apportées suite à la dernière révision de la carte ( nouveaux chemins, nouveaux bâtiments ¼ ).
La carte et le reliefLa lecture d'une carte en trois dimensions n'étant pas encore complètement au point ( pour ceux que ça intéresse, il y aurait un créneau ), il a fallu trouver un moyen pour indiquer le relief sur une carte.
Sur les cartes les plus anciennes, on faisait appel aux hachures : celles-ci avaient l'avantage de fournir explicitement une idée du relief ( plus les hachures étaient serrées, plus la pente était forte ), mais elles avaient le gros inconvénient de noircir la carte et de rendre celle-ci illisible. De plus, elles ne faisaient qu'indiquer l'importance des pentes, mais pas les altitudes.
Les cartes actuelles font appel aux courbes de niveau, lignes qui rejoignent tous les points de même altitude, plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont rapprochées les unes des autres. Les fortes pentes sont renforcées par un ombrage léger. Une personne se déplaçant le long d'une courbe de niveau reste à la même altitude.
L'altitude 0 est référencée par rapport au niveau de la mer pris à Marseille ( niveau moyen déterminé après une observation de plus de dix ans ).
La différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives se nomme l'équidistance des courbes : sa valeur varie suivant l'échelle de la carte et suivant que l'on a une carte de plaine ou une carte de montagne. En général, l'équidistance des courbes d'une carte au 1/50000 est de 20 mètres et celle d'une carte au 1/25000 est de 5 mètres.
Toutes les 5 courbes de niveau, la courbe maîtresse est indiquée par un tracé plus épais.
Des courbes intercalaires peuvent être indiquées dans le cas de faibles pentes : elles sont portées en pointillé.
A certains endroits de la courbe ( maîtresse ou intercalaire ), le chiffre de l'altitude repérée par la courbe est indiqué, il est écrit de telle sorte que le haut des chiffres est dirigé vers le haut.
Des points cotés jalonnent la carte, ils indiquent l'altitude exacte du lieu considéré : il y en a 400000 en France, l'altitude est référencée par rapport à Marseille.
Les points géodésiques sont des points particuliers ( généralement cotés ) dont les coordonnées sont connues très précisément et déterminées par rapport à la croix du Panthéon à Paris ( il y en a 100000 en France ).
Il est important de pouvoir se faire une idée très précise du relief à la simple vue de la carte, cela peut aider en compétition pour régler les allures ... Pour cela, on peut réaliser quelques exercices pratiques avec une feuille de papier calque quadrillée et un crayon.
Il convient aussi de connaître les formes caractéristiques telles que la ligne de crête, le Thalweg, le mamelon, le col ...

A noter : sur les cartes au 1/25000, on trouve assez souvent une indication en noir " R.N. ". Celle-ci indique non pas une route nationale ( cette indication peut se trouver en plein milieu d’un bois ) mais un repère de nivellement matérialisé sur le terrain par une pastille de plomb de quelques cm de diamètre portant l’inscription " Nivellement Général de la France " et l’altitude exacte de cette pastille. Le repère de nivellement est généralement situé sur un mur à 70-80 cm du sol, il pourra faire l’objet de recherches dans des rallyes.
Si vous ne connaissez pas l'échelle de votre carte, vous pouvez vous reporter aux indications kilométriques qui figurent sur le cadre et à partir d'elles, en déduire l'échelle de la carte.
Il est aussi possible de repérer un point sur la carte par ses coordonnées kilométriques rapportées au quadrillage "Lambert zone II étendue".
Ainsi, le siège social du CDTE Vienne se trouve aux coordonnées hectométriques 21767 Nord et 4533.25 Est.
Rappel : les amorces du quadrillage "Lambert zone II étendue" se retrouvent sur la carte au 1/25000 sous forme de croix qui délimitent entre elles des carrés d'un kilomètre de côté, soit 4 cm sur la carte.
Le haut de la carte est dirigé vers le Nord, les écritures sont d'Est en Ouest et dirigées vers le Nord.
Tout le problème consiste alors à se situer et à s'orienter sur la carte en utilisant des repères visibles ( route, tour, église ... ), mais ce n'est pas très précis et peu recommandé.
Avec le soleil"Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest !"
Voila une affirmation un peu grossière car elle n'est valable qu'à la latitude 45° le 21 Avril ( Equinoxe de printemps ) et le 21 Septembre ( Equinoxe d'automne ) à 6 heures et 18 heures.
Cependant, ce qui est sûr, c'est que le soleil est au Sud à midi heure solaire.
Avec beaucoup d'entraînement, il devient aisé de déterminer, approximativement, les quatre points cardinaux en regardant le soleil.
Avec une montreSupposons une montre à aiguille ( rare ), réglée à l'heure solaire ( encore plus rare ) : si on dirige la petite aiguille dans la direction du soleil, la bissectrice entre la petite aiguille et l'axe du 12 de la montre détermine la direction Nord-Sud, le Nord étant vers vous si vous tenez la montre devant vous.
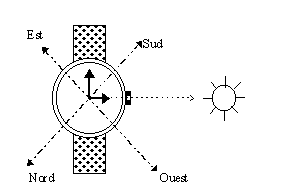
Il faut apprendre à repérer la grande ourse et de là, la petite ourse : l'étoile la plus volumineuse de la petite ourse est l'étoile polaire orientée vers le Nord et possédant la particularité non négligeable d'être fixe dans le ciel tout au long de la nuit et de l'année.

Il faut savoir que la pleine lune est au sud à minuit, au nord à midi et inversement pour la nouvelle lune.
Nord |
Est |
Sud |
Ouest |
|
Nouvelle
lune |
24 h |
6 h |
12 h |
18 h |
Premier quartier |
6 h |
12 h |
18 h |
24 h |
Pleine lune |
12 h |
18 h |
24 h |
6 h |
Dernier quartier |
18 h |
24 h |
6 h |
12 h |
A côté d'une église
Conformément à la position de la croix chrétienne, l'autel des églises est, généralement, dirigé vers l'Est, le transept est alors orienté Nord-Sud.
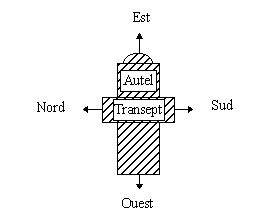
Inventée par les chinois 2000 ans avant notre ère, la boussole utilise le principe qui veut qu'une aiguille aimantée qui tourne librement s'oriente toujours dans la même direction, c'est à dire le Nord magnétique : on en déduit aisément la position des autres points cardinaux.
Les anglesLa boussole faisant intervenir des angles, il convient de connaître les différentes mesures d'angles utilisées :
| le degré : unité de base, division sexagésimale. 1 tour complet = 360°, un angle droit = 90°. Le degré se divise en minutes et se subdivise en secondes ( 1° = 60' = 3600" ). | |
| le grade : unité des topographes, division centésimale. 1 tour complet =400 Gr. Le grade se divise en décigrades et en centigrades ( 1 Gr = 10 dGr = 100 cGr ). | |
| le millième : unité des militaires dont la définition est "angle par lequel est vu à une distance de 1000m un objet de 1m de hauteur". 1 tour complet représente 6400 millièmes, l'angle droit fait 1600 millièmes. |
L'unité d'angle la plus employée par les randonneurs est le degré, cependant, il convient de connaître les correspondances car en compétition, les organisateurs pourraient pousser le vice jusqu'à annoncer des angles en millième.
On doit à Copernic la preuve de l'existence du Nord géographique = Nord vrai par lequel passe l'axe de rotation de la Terre.
Le Nord indiqué par la boussole n'est pas le Nord vrai, il s'agit du Nord magnétique.
Si le Nord vrai est fixe et immuable dans le temps, il n'en est pas de même du Nord magnétique qui varie, très sensiblement, tous les jours : en effet, il se déplace depuis sa position actuelle ( Nord-Est du Canada ) vers le Nord-Ouest de l'Europe.
L'angle qui sépare les deux directions ( Nord vrai et Nord magnétique ) s'appelle la déclinaison magnétique, sa mesure n'est bien sûr pas fixe et varie dans le temps et l'espace. Avec les légendes de la carte, il est indiqué la valeur de cet angle ainsi que son évolution dans le temps. Au 1er Janvier 1990, sa valeur était de 4° 21' au centre de la feuille 1927 Est.
L'angle entre le Nord et la direction à suivre s'appelle l'azimut : on distingue l'azimut géographique ( angle entre la direction à suivre et le Nord vrai ) de l'azimut magnétique = angle de marche ( angle entre la direction à suivre et le Nord magnétique ).
Le Nord Lambert = Nord de la carte est un troisième Nord peu utilisé; l'angle entre ce Nord et la direction à suivre s'appelle le gisement.
Les différents types de boussoleUne bonne boussole doit disposer d'une capsule qui tourne facilement, d'un liquide - dans lequel baigne l'aiguille - tel qu'il favorise la stabilisation rapide de l'aiguille, d'un boîtier résistant, d'un système de visée.
La boussole doit être munie d'un cordon qui permet de ne pas la perdre, cependant, elle ne doit pas pendre autour du cou car elle risque de s'enrouler ou de s'accrocher à une branche d'où le risque de strangulation.. Le mieux est de disposer d'un étui fixé à la selle ou à la ceinture et d'un cordon assez long pour pouvoir être fixé à la selle ou à la ceinture sans pour cela empêcher l'utilisation de l'instrument. On peut aussi mettre la boussole dans une poche de la veste ou de la chemise et fixer le cordon à la boutonnière du vêtement.
Il existe de nombreux types de boussole sur le marché, le plus répandu et le moins cher est la "boussole-plaquette" type course d'orientation. Ma préférence va cependant vers les boussoles avec élément de visée comme le miroir.
Ne pas utiliser la boussole sous une ligne à haute tension, à coté d'un transformateur ou d'une masse métallique : l'aiguille y perd le Nord !
Certains vous recommanderont le tournesol dont les têtes sont tournées vers l'Est ( en fait, elles suivent plus ou moins la course du soleil et dans l'ensemble sont plus vers le Sud ), la mousse des arbres au Nord ( dans certaines forêts humides, la mousse est sur tout le tronc ), la pluie qui tombe venant de l'Ouest ( ? ) : bref, tous ces "trucs" ne sont pas recommandés ni recommandables.
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de placer la boussole sur le bord de la carte parallèlement au trait vertical du cadre de la carte et de tourner l'ensemble jusqu'à ce que l'aiguille aimantée de la boussole coïncide avec le zéro de la boussole.
Se situer sur la carteUne première méthode consiste à regarder le paysage et à essayer de trouver la même chose sur la carte : méthode laborieuse et peu fiable mais rapide et envisageable si toutefois on n'est pas complètement perdu.
Une autre méthode consiste à faire des relevés d'azimuts ( au moins deux ) avec la boussole à partir de points remarquables ( tour, église, éolienne ... ). On reporte ensuite sur la carte les azimuts géographiques ( tenant compte de la déclinaison magnétique ) et on obtient alors plusieurs droites : le point de concours de ces droites est l'endroit où vous vous situez ( ce principe est bien connu de tous les marins qui font de la navigation côtière ).
Relever un azimutIl faut déterminer l'azimut géographique correspondant à la direction à prendre, puis le traduire en azimut magnétique : il suffit alors de faire une visée et de repérer sur le terrain un objet fixe ( arbre, monument ... ) dans la direction duquel on se dirigera.
Remarque : pour transformer un azimut géographique en azimut magnétique ‚ , il existe un truc bien pratique pour ne pas se tromper. Quand on transforme en ‚ , on passe de la carte ( posée à terre ) à la boussole ( tenue en main ) et donc on se relève : il faut ajouter la valeur de la déclinaison magnétique à pour obtenir ‚ .
L'orientation en compétitionNous allons évoquer ici le moyen de s'en sortir en compétition telle que le TREC ou le Challenge du Cavalier et du Cheval d'Extérieur.
Il faut ici considérer les deux acteurs, à savoir le cheval et le cavalier.
Il joue un rôle non négligeable puisqu'il doit supporter les humeurs de son cavalier et il est le premier à faire les frais des erreurs de son cavalier.
Un bon cheval de compétition ne doit pas avoir peur de la carte dépliée au dessus de sa tête, voire posée sur son encolure, et qui fait un bruit inquiétant à cause du vent : il doit donc savoir rester immobile quand le cavalier "travaille".
En outre, le cheval doit pouvoir être mené d'une seule main car vous aurez besoin de l'autre pour tenir la carte ou la boussole ...
Il est important aussi que le cavalier ait étalonné sa monture car dans les épreuves à la boussole, les distances parcourues doivent être estimables le plus précisément possible. Pour cela, le cavalier peut utiliser un podomètre, mais cette solution n'est pas sans risque car l'appareil n'a pas été conçu pour fonctionner avec un cheval. L'autre solution consiste à chiffrer le déplacement du cheval sur une distance connue ( par exemple 400 m ) : ce chiffrage peut se faire soit en calculant le temps que met le cheval à parcourir cette distance, soit en comptant le nombre de foulées nécessaires au cheval pour parcourir cette distance à un trot bien défini. Ces deux méthodes peuvent être critiquées car le cheval peut ne pas marcher à la même vitesse le jour du test et le jour de la compétition, cependant, il appartient au cavalier d'être suffisamment observateur pour juger de la régularité des allures.
Le cavalierLes outils de base sont la boussole, le curvimètre, un feutre fluo pointe fine, un critérium, un carnet de notes ( pour noter tous les renseignements donnés par les organisateurs ), un chronomètre et une table de conversion vitesse-distance-temps.
On peut aussi se munir d'une ficelle ( pour déterminer des coordonnées ), d'un rapporteur ( pour mesurer les angles ), d'une machine à calculer ( si votre calcul mental est peu fiable ).
Pour emporter tout cela, tout en gardant l'ensemble à portée de main, un blouson sans manches avec de multiples poches ( qui ferment bien ) est vivement recommandé.
En cas d'intempérie, un porte-carte est indispensable si on veut que la carte reste lisible sur toute l'épreuve : les porte-cartes pour course d'orientation conviennent tout à fait; un simple protège document transparent fera tout aussi bien l'affaire.
Il peut arriver que le parcours soit à faire de nuit, ou qu'il se prolonge en début de soirée : dans ce cas il faut prévoir un éclairage. Une lampe de cycliste fixée à la jambe vous permettra de signaler votre présence aux autres usagers; une lampe frontale type spéléo avec convergence du faisceau variable et ampoule halogène sera la bienvenue pour vous aider à y voir plus clair ( n'oubliez pas piles et ampoules de rechange ) : les grosses lampes à éclairage intense sont à proscrire puisque trop encombrantes et trop puissantes. En effet, le cheval voit très bien la nuit et si vous projetez devant lui un faisceau lumineux intense, vous risquez de l'éblouir : il peut alors trébucher ou prendre peur de n'importe quoi. De plus, ce type de lampe mobilise une main et vous n'avez plus qu'une main pour diriger le cheval et tenir la carte.
Le relevé de l'itinéraireIl faut procéder dans l'ordre et dans le calme. Il faut d'abord essayer d'avoir une vue d'ensemble de l'itinéraire puis commencer par le début du parcours à reporter sur la carte qui vous est fournie l'itinéraire proposé en prenant bien soin de vérifier que l'itinéraire tracé est en tout point comparable à celui relevé : en particulier, faites attention aux tracés qui n'empruntent pas les voies tracées, il peut y avoir à cet endroit un itinéraire à emprunter à travers bois ...
L'itinéraire est relevé au moyen du feutre fluo, sa couleur a de l'importance. En effet, le jaune ne se voit pas la nuit, le bleu et le vert peuvent être confondus avec les couleurs de la carte : le rose ou le rouge sont tout à fait appropriés.
Si les organisateurs ont prévu plusieurs cartes portant le tracé, vérifiez sur les autres cartes l'exactitude de votre relevé.
Juste avant le départ, pensez à plier votre carte de façon que seules les parties portant l'itinéraire soient visibles : il est parfois malaisé ( pluie, vent ... ) de plier la carte en cours de route.
Le métrage de l'itinéraireUne fois l'itinéraire relevé et vérifié, votre travail n'est pas fini, il vous faut métrer cet itinéraire. Pour cela, vous allez utiliser le curvimètre en prenant bien soin de le déplacer toujours dans le même sens. Tous les 2 km par exemple, vous allez porter un repère sur votre carte ( trait au crayon de bois avec chiffre correspondant ).
Le curvimètre est jugé par certains trop imprécis, ils lui préfèrent le "calque totalisateur". C'est une feuille de papier calque de 3 cm de long sur laquelle on a pris soin de tracer un trait de 2 cm : le but du jeu consiste à déplacer ce calque en faisant correspondre le trait avec l'itinéraire et à noter les kilométrage tous les km ou 2 km. Cette méthode adoptée par les "professionnels" du TREC me semble un peu laborieuse et très astreignante dans le cas d'un itinéraire sinueux, de plus, elle ne permet pas une fois en selle de vérifier des distances, à moins d'avoir aussi sur soi une plaquette rigide et de prendre le temps de s'arrêter.
La régularité à chevalLe mieux est de se servir d'un chronomètre. Vous déclenchez le chronomètre au départ du tronçon dont vous connaissez la moyenne horaire imposée. Connaissant la moyenne horaire, vous déterminez grâce à votre table de conversion vitesse-distance-temps le temps nécessaire pour parcourir 1 ou 2 km et grâce au métrage de la carte que vous avez pris soin d'effectuer au moment du relevé de l'itinéraire, vous connaissez maintenant vos horaires de passage en des lieux bien précis de l'itinéraire.
Il vous fait aussi tenir compte du relief ( vous aurez sans doute du mal à tenir les 12 km/h en montée ou en descente ), des lieux de passage de l'itinéraire ( s'il y a une rivière à traverser, pensez à y amener votre cheval relativement sec pour qu'il n'attrape pas de mal en traversant ), pensez aussi que certaines allées en forêt peuvent être défoncées, surtout s'il y a de la chasse à cour ...
Les pièges à éviterFaites très attention lors du relevé de l'itinéraire, tous les détours doivent être notés très scrupuleusement car ce sont généralement des détours voulus par l'organisateur qui aura prévu un contrôle pour jouir de l'efficacité de son piège.
N'oubliez pas que la carte est remise à jour en moyenne tous les 10 ans et que donc, il peut y avoir une grosse différence entre ce qui est sur votre carte et ce qui existe sur le terrain ( là où est indiquée une forêt sur la carte peut maintenant se trouver une cité résidentielle, rarement l'inverse ).
Il est impératif en compétition de savoir estimer les distances surtout si on se trouve dans une forêt où toutes les allées ont le même azimut ( remarque : ceci n'est valable que si les organisateurs se donnent la peine de métrer leur itinéraire avec exactitude ).
Il est aussi important en compétition d'avoir une idée du relief rien qu'en lisant la carte : deux chemins parallèles et peu éloignés l'un de l'autre peuvent se reconnaître par le relief qui leur est propre.
Dans un carrefour en étoile, prenez la peine de vérifier avec votre boussole l'azimut à prendre : le chemin correct n'est pas forcément apparent, il peut être caché et vous pourriez être tentés de prendre un mauvais chemin.
![]()